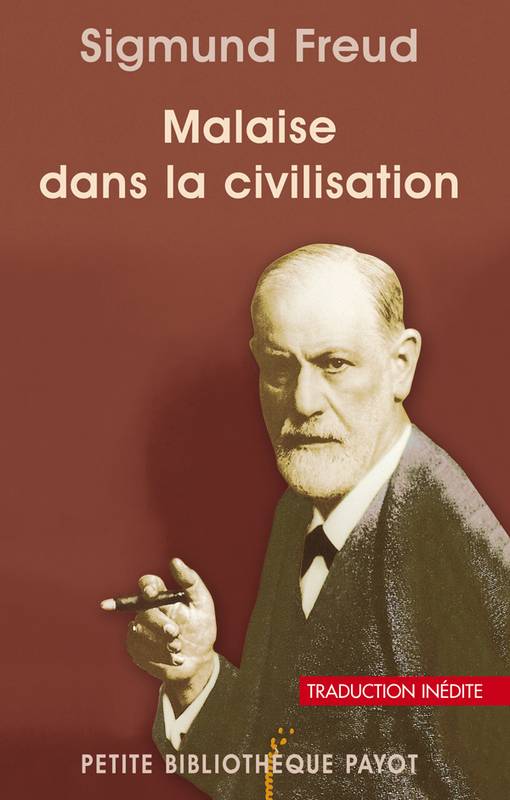Sigmund Freud
Le malaise dans la civilisation
Cet essai aborde de nombreuses interrogations philosophiques, voire métaphysiques. Je suis loin d’être un spécialiste de Freud, et la Gestalt s’est à de nombreux égards détachée de certaines interprétations psychanalytiques. Toutefois, sans en ignorer ses limites et ses faiblesses, ses détracteurs et la remise en question de certains de ses résultats cliniques, il me semble toujours intéressant de reprendre une lecture « naïve » d’un auteur aussi majeur que Freud.
Cet ouvrage semble un peu construit avec la même logique que sa vision du développement de l’être humain. Il commence d’abord par ce « tout indifférencié » décrivant cet état originel où l’on ne distingue pas le moi du monde ou le monde du moi… la matrice originelle. Il parle du sentiment « océanique » d’être relié au tout, à plus vaste que soi, comme une sorte de réminiscence de notre « moi » premier « ce sentiment qu’a l’adulte de ne pas avoir été dès le début tel qu’il est ». « Originairement, le Moi contient tout, par la suite il évacue un monde extérieur. Notre actuel sentiment du Moi n’est donc qu’un reste atrophié d’un sentiment du Moi beaucoup plus global ».
J’aimerais ici citer le magnifique ouvrage de Jill Bolte Taylor « My stroke of insight », traduit sous le titre « Voyage au-delà de mon cerveau », qui décrit avec toute la précision d’une neuro-scientifique son expérience d’une attaque cérébrale touchant son cerveau gauche. Cette sensation d’être connectée au tout océanique, à toute chose, elle l’a vécu alors que son cerveau gauche n’était presque plus fonctionnel et qu’elle était sous « domination » de son cerveau droit. Voici un regard neurologique passionnant sur le développement de la psyché et de l’individuation.
Freud aborde ensuite les grandes question humaines du bonheur et de la souffrance. « Nous sommes ainsi faits que nous ne pouvons jouir intensément que de contraste, et très peu d’un état. De ce fait, nos possibilités de bonheur sont déjà limitées par notre constitution. Il y a beaucoup moins de difficultés à faire l’expérience du malheur. La souffrance menace de trois côtés : de notre propre corps, (…), du monde extérieur, (…), et enfin des relations avec d’autres êtres humains. »
Il évoque les stratégies possibles pour éviter la souffrance (l’isolement si la souffrance est engendrée par les relations humaines, se libérer des pulsions si la souffrance est causée par la frustration qu’elles ne soient pas assouvies -en les tuant, en les sublimant, en les réprimant-, entrer dans l’illusion d’un imaginaire, jusqu’à la névrose ou la psychose…, porter son attention sur l’amour et la beauté, etc). On peut ainsi « donner la priorité au contenu positif du but (obtenir du plaisir), ou au contenu négatif (éviter du déplaisir) ». Et de préciser « le bonheur, au sens relatif où il est reconnu comme possible, est un problème d’économie libidinale individuelle. Il n’y a pas là de conseil valable pour tout le monde ». Ce qui est plutôt rassurant !
Freud entre ensuite dans le vif du sujet, la source sociale de la souffrance : Contrairement aux autres sources, « elle, nous ne voulons tout simplement par l’accepter, nous ne pouvons comprendre pourquoi les dispositions que nous avons nous-mêmes créées ne devraient pas, bien plutôt, être une protection et un bienfait pour nous tous. »
« Le mot ‘civilisation’ désigne la somme des actions et des dispositifs dans lesquels notre vie s’écarte de celle de nos ancêtres animaux et qui servent deux fins : protéger l’être humain contre la nature et régler les relation des hommes entre eux. »
« C’est le remplacement du pouvoir de l’individu par celui de la communauté qui constitue le pas décisif vers la civilisation. »
« Apparemment, on ne saurait amener l’homme, par quelque influence que ce soit, à transformer sa nature en celle d’un termite, sans doute défendra-t-il toujours sa revendication de liberté individuelle contre la volonté de masse. Une bonne partie du combat de l’humanité s’agglomère autour de la tâche consistant à trouver un compromis efficace, c’est-à-dire heureux, entre ces revendications individuelles et et les revendications de masse, qui sont de civilisation ; c’est là un des problèmes cruciaux : ce compromis peut-il être obtenu en donnant une certaine forme à la civilisation, ou le conflit est-il insurmontable ? »
Freud revient ensuite sur les origines de la civilisation, l’apparition de la famille chez l’homme primitif. Le degré suivant de la vie en commun se ferait sous la forme d’alliance entre frères. Il reprend cette thèse développée dans ‘Totem et Tabou’ en écho au mythe d’Oedipe : « en abattant le pouvoir du père au profit du leur, les fils avaient expérimenté qu’une union pouvait être plus forte que l’individu ». L’amour reste selon lui le ciment principal de la civilisation, mais le passage de l’amour sexuel à un amour plus fraternel engendre des tabous. L’amitié est pour lui la conséquence d’un amour sexuel inhibé.
Il est intéressant de voir comment Freud balaye d’un revers de main l’idée d’un amour du prochain prôné par certains sages, qui « se rendent indépendants du consentement de l’objet en plaçant la valeur principale de l’amour non plus dans le fait d’être aimés, mais dans le fait d’aimer eux-mêmes ; ils se mettent à l’abri de la perte en tournant leur amour non vers des objets individuels, mais vers tous les êtres humains au même titre. » Ses deux objections y sont : « Un amour qui ne choisit pas nous paraît perdre une part de sa propre valeur en faisant tort à son objet. Et de plus : tous les êtres humains ne valent pas d’être aimés. » Ces deux objections pourraient alimenter de nombreux débats encore aujourd’hui, non ?
Ceci permet à Freud d’arriver à une sorte de paradoxe de la civilisation : elle est bâtie sur l’amour mais puisque selon lui cet amour est d’abord sexuel, elle va aussi générer des tabous, dont « l’interdit de l’inceste dans le choix d’objet » en est une expression. La civilisation « recourt massivement à de la libido inhibée quant à son but, afin de renforcer des liens communautaires par des relations d’amitié. Pour que ces intentions aboutissent, la restriction de la vie sexuelle devient inévitable. » Freud s’interroge ensuite sur la nécessité qui pousse la civilisation à être hostile à la sexualité ?
Il reprend les injonctions civilisées du type « aime ton prochain comme toi-même » ou « aime tes ennemis » pour les mettre en cause car selon lui « la portion de réalité, volontiers niée, qui se trouve derrière tout cela, c’est que l’être humain n’est pas un être doux, ayant besoin d’amour et capable tout au plus de se défendre quand on l’attaque, mais qu’il peut se targuer de compter au nombre de ses dons instinctifs une grosse part d’agressivité ». Et de citer la phrase de Plaute reprise par le philisophe anglais Th. Hobbes (1588-1679) : Homo homini lupus (l’homme est un loup pour l’homme)…
« Du fait de cette hostilité primaire des êtres humains les uns envers les autres, la société civilisée est constamment menacée de se désagréger. (…) La civilisation doit tout mettre en œuvre pour dresser des barrières devant les instincts agressifs des hommes. (…) Les plus grossiers débordements de force brutale, la civilisation espère y faire obstacle en s’arrogeant le droit d’exercer elle-même la violence contre les criminels ; mais les manifestations plus prudentes et plus subtiles de l’agressivité humaine, la loi n’a pas de prise sur elle. »
Une manière de gérer cette agressivité naturelle de l’homme, Freud la décrit comme un « narcissisme des petites différences » quand il s’agit de « communautés limitrophes assez comparables qui se disputent et se moquent les unes les autres : (…) il est toujours possible de lier ensemble, dans l’amour, un assez grand nombre d’êtres humains, pourvu qu’il en reste d’autres envers lesquels manifester leur agressivité. (…) Disséminé de toutes parts, le peuple des Juifs a rendu de cette façon de signalés services aux civilisations des peuples qui l’hébergeaient ».
« Si la civilisation impose d’aussi grands sacrifices non seulement à la sexualité de l’homme, mais aussi à son agressivité, nous comprenons mieux qu’il ait du mal à y trouver son bonheur ».
Mais après avoir semble-t-il pris le chemin d’une certaine forme de critique de la civilisation, Freud se garde bien de prendre partie et fait part au final de son impartialité : « Aussi le courage m’abandonne-t-il pour me planter en prophète devant mes frères humains, et je m’incline devant le reproche qu’ils me font de ne pas savoir leur apporter de réconfort ; car c’est ce qu’ils réclament au fond tous, les révolutionnaires les plus farouches tout aussi passionnément que les dévots les plus dociles. »